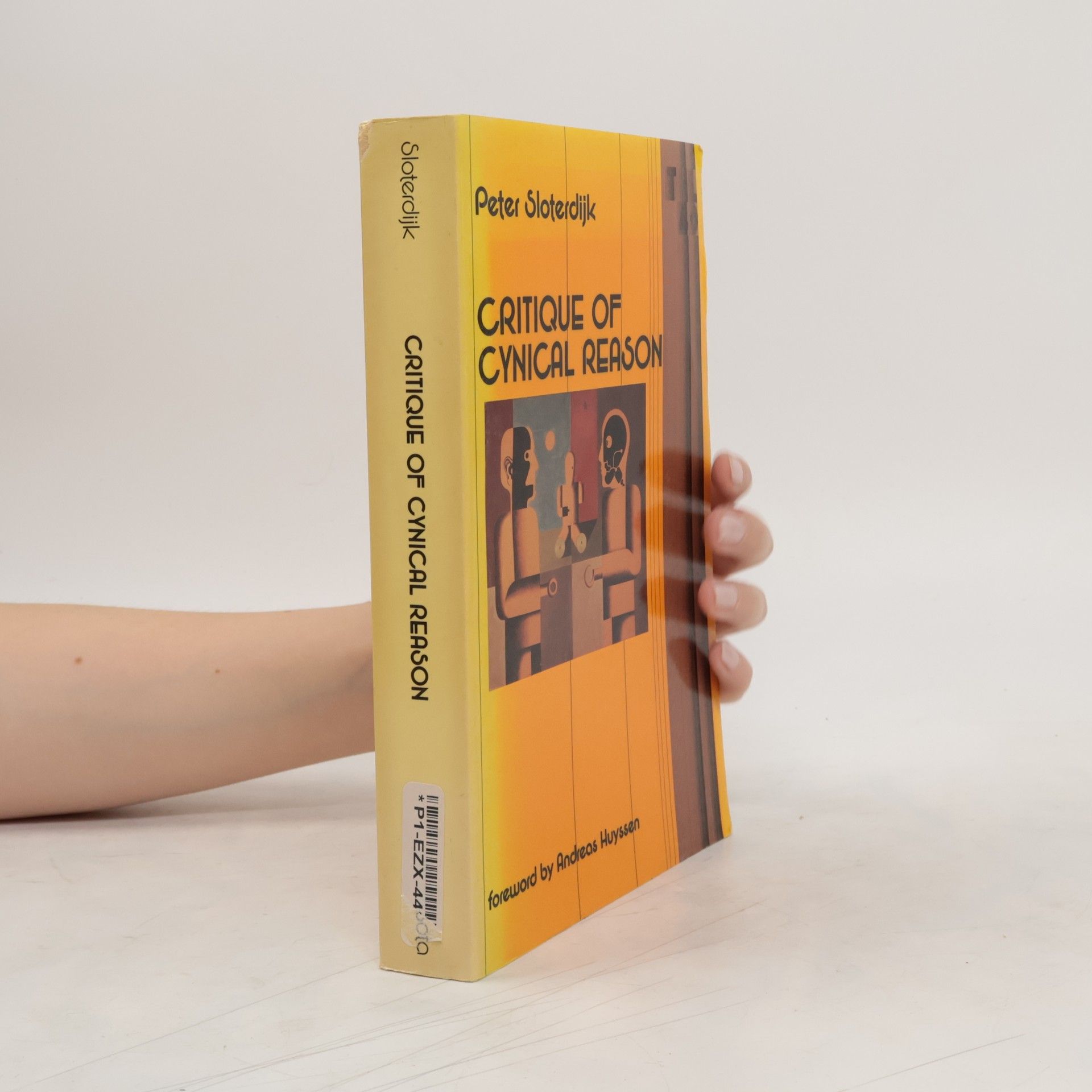« Dans l'Antiquité, la sphère est la représentation de la perfection de ce qui n'a ni commencement, ni fin, échappe à la corruption du temps, symbolise le divin qui s'offre à la contemplation. Depuis les Grecs, la totalisation du monde s'opère sous la forme d'un globe, à la fois vision cosmogonique, projection géométrique et spéculation philosophique, mais aussi représentation physique de la souveraineté et attribut des empereurs, monarques ou papes. Quand s'ouvre le monde, quand la circonférence ne le contient plus et que les hiérarchies sont bouleversées, que devient cette représentation dont nous sommes malgré tout les héritiers ? Suffit-il de la déclarer obsolète pour en être affranchi ? Avec son brio habituel de conteur, Peter Sloterdijk nous entraîne dans un voyage passionnant à travers les civilisations et les époques, au gré de la position qu'y occupe le centre de la sphère. »--Quatrième de couverture
Peter Sloterdijk Livres
Peter Sloterdijk est un philosophe et théoricien culturel allemand dont les œuvres explorent des questions profondes de l'existence humaine et de la société moderne. Son style se caractérise par une pensée provocatrice et une analyse incisive des phénomènes culturels contemporains. Des œuvres clés, telles que la trilogie 'Sphères', examinent la relation entre l'humanité et son environnement, soulignant l'influence des structures sociales et technologiques. L'écriture de Sloterdijk met au défi les lecteurs de réévaluer les concepts traditionnels et de s'engager activement dans la formation des sociétés futures.


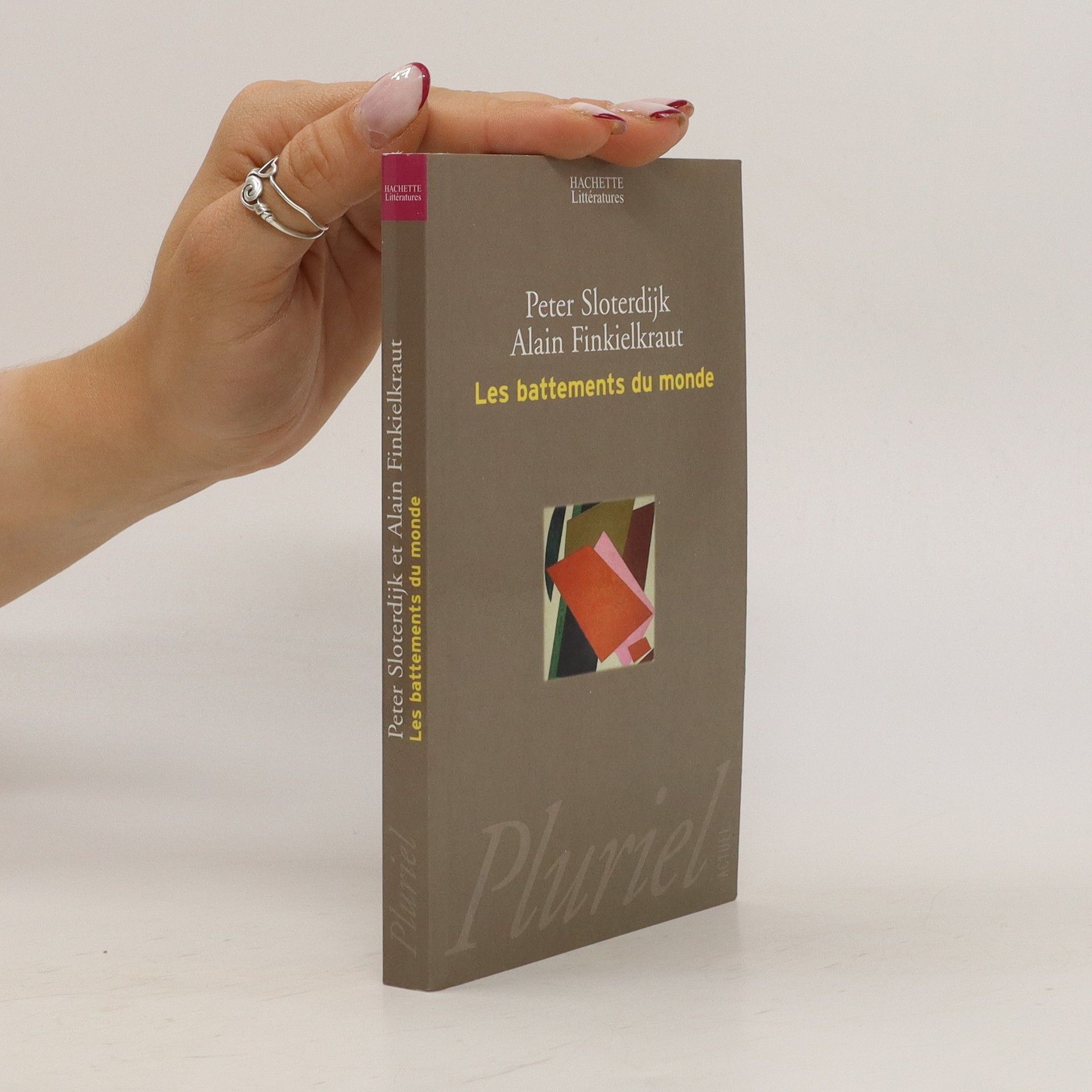

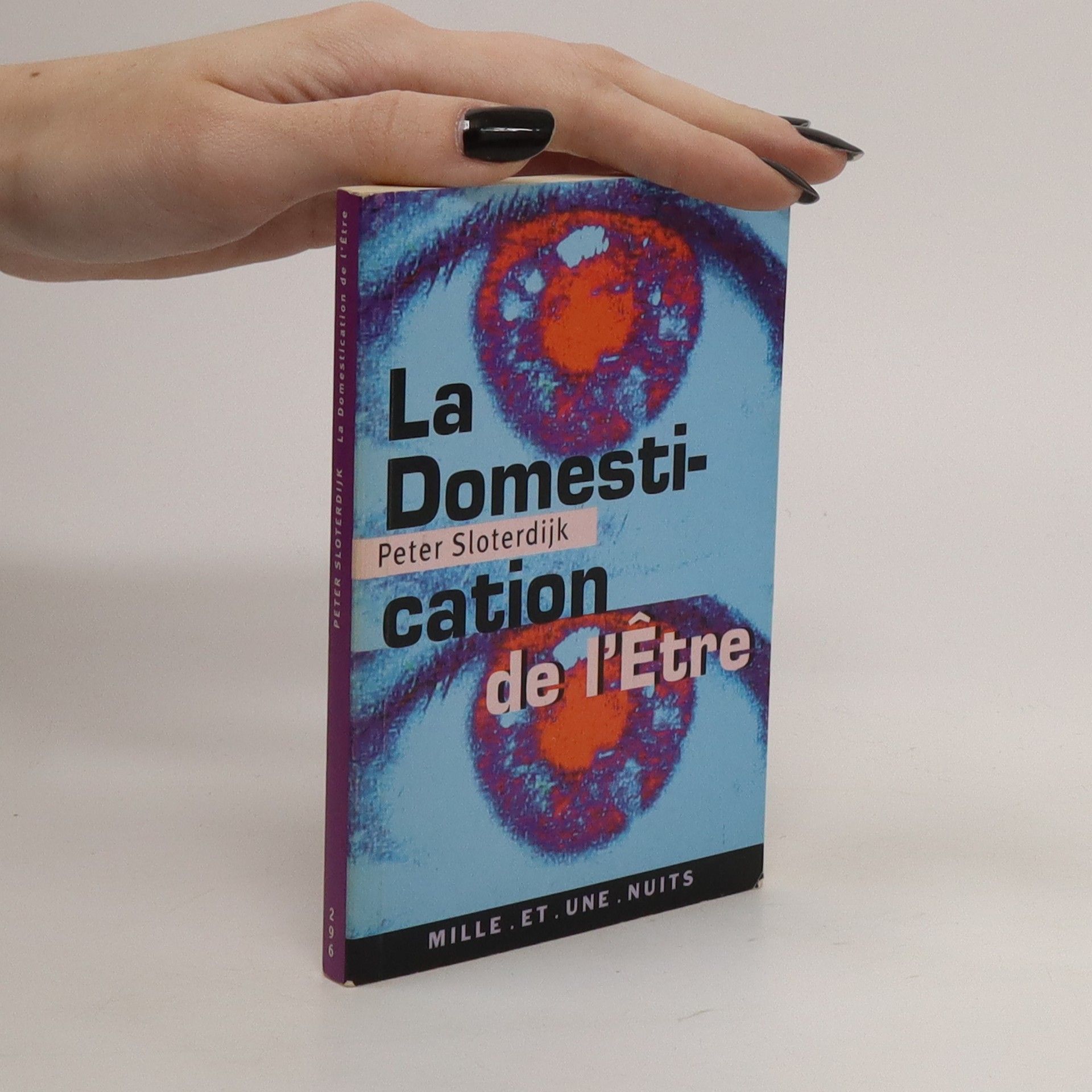


Sphères 1
- 687pages
- 25 heures de lecture
Bulles et Globes font partie d'une trilogie monumentale qui propose, selon son traducteur, «rien de moins qu'une histoire philosophique de l'humanité à travers le prisme d'une forme fondamentale : la sphère, et trois de ses déclinaisons, la bulle, le globe, et l'alvéole d'écume»
La domestication de l'être : pour un éclaircissement de la clairière
- 111pages
- 4 heures de lecture
S'inspirant à nouveau du motif de la « clairière » de Martin Heidegger comme il l'avait fait dans Règles pour le parc humain (resté inachevé en raison de la polémique que ce texte a suscité) l'auteur propose de renouveler l'approche de l'auteur de Sein und Zeit en l'ouvrant à l'anthropologie, voire à une paléoanthropologie. Cette « ontoanthropologie » se propose de réfléchir sur la production de l'homme par lui-même en insistant notamment sur son rapport indissociable à l'espace ou l'environnement (Umwelt, selon le concept introduit par Jakob von Uexküll).Selon Sloterdijk, la domestication de l'Être passe par la distanciation de l'homme à l'égard de la nature, notamment par l'usage des outils. Cette thèse fait écho aux théories de Paul Alsberg et, avant lui, de Hugh Miller qui avait proposé le concept d'« insulation » par lequel il désignait la protection d'êtres vivants de l'extérieur par leurs semblables, notamment de la femme et des enfants.Ces « anthropotechniques » se prolongent dans les technologies génétiques actuelles qui remettent en question la définition de l'homme et mettent en évidence l'idée d'une autoproduction de l'homme que le philosophe jésuite Karl Rahner avait désigné durant les années 1960 par l'expression d'« homme opérable » (Operable Mensch).
Ni le soleil, ni la mort
- 435pages
- 16 heures de lecture
Dans Ni le soleil ni la mort, jeu de piste sous forme de dialogues, Peter Sloterdijk renoue avec le style nerveux et la simplicité d'expression qui avaient fait le succès d'Essai d'intoxication volontaire (Calmann-Levy, 1999). Il poursuit le fil d'Ariane qui traverse l'ensemble de son œuvre, dévoile les motivations existentielles et métaphysiques de ses explorations et explique les grands thèmes de ses livres, notamment de sa trilogie Sphères. Pour l'auteur, il est temps de passer d'une philosophie rationnelle et vitrifiée à une pensée en mouvement, imprégnée de l'anthropologie de la poésie et de l'art, de la relation créatrice entre l'âme humaine et l'univers. Une philosophie des sphères donc, qui permet d'intégrer la technique à notre propre évolution, de la maîtriser et de la rendre compatible avec notre environnement naturel et social. Ni le soleil ni la mort nous fait partager une énergie spéculative qui évalue toutes les dimensions de l'existence en rapport avec les mutations du monde.
Série d'échanges ayant eu lieu depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, entre les philosophes français et allemand à propos de la marche du monde, l'utopie politique, le rapport à l'autre dans les faits, la situation des juifs, les mutations des sociétés modernes, etc.
Spheres
- 912pages
- 32 heures de lecture
An epic project in both size and purview, Peter Sloterdijk's three-volume, 2,500-page Spheres is the late-twentieth-century bookend to Heidegger's Being and Time. Rejecting the century's predominant philosophical focus on temporality, Sloterdijk, a self-described "student of the air," reinterprets the history of Western metaphysics as an inherently spatial and immunological project, from the discovery of self (bubble) to the exploration of world (globe) to the poetics of plurality (foam). Exploring macro- and micro-space from the Greek agora to the contemporary urban apartment, Sloterdijk is able to synthesize, with immense erudition, the spatial theories of Aristotle, René Descartes, Gaston Bachelard, Walter Benjamin, and Georges Bataille into a morphology of shared, or multipolar, dwelling-identifying the question of being as one bound up with the aerial technology of architectonics and anthropogenesis."-
In this essential early work, the preeminent European philosopher Peter Sloterdijk offers a cross-cultural and transdisciplinary meditation on humanity's tendency to refuse the world. Developing the first seeds of his anthropotechnics, Sloterdijk develops a theory of consciousness as a medium, tuned and retuned over the course of technological and social history. His subject here is the "world-alien" in man that was formerly institutionalized in religions, but is increasingly dealt with in modern times through practices of psychotherapy. Originally written in 1993, this almost clairvoyant work examines how humans seek escape from the world in cross-cultural and historical context, up to the mania and world-escapism of our cybernetic network culture. Chapters delve into the artificial habitats and forms of intoxication we develop, from early Christian desert monks to pharmaco-theology through psychedelics. In classic form, Sloterdijk recalibrates and reinvents concepts from the ancient Greeks to Heidegger to develop an astonishingly contemporary philosophical anthropology.
After God
- 280pages
- 10 heures de lecture
After God is dedicated to the theological enlightenment of theology. It ranges from the period when gods reigned to reveries about the godlike power of artificial intelligence--
You must change your life
- 503pages
- 18 heures de lecture
In his major investigation into the nature of humans, Peter Sloterdijk presents a critique of myth - the myth of the return of religion. For it is not religion that is returning; rather, there is something else quite profound that is taking on increasing significance in the present: the human as a practising, training being, one that creates itself through exercises and thereby transcends itself. Rainer Maria Rilke formulated the drive towards such self-training in the early twentieth century in the imperative 'You must change your life'. In making his case for the expansion of the practice zone for individuals and for society as a whole, Sloterdijk develops a fundamental and fundamentally new anthropology. The core of his science of the human being is an insight into the self-formation of all things human. The activity of both individuals and collectives constantly comes back to affect them: work affects the worker, communication the communicator, feelings the feeler. It is those humans who engage expressly in practice that embody this mode of existence most clearly: farmers, workers, warriors, writers, yogis, rhetoricians, musicians or models. By examining their training plans and peak performances, this book offers a panorama of exercises that are necessary to be, and remain, a human being.
Critique of Cynical Reason
- 558pages
- 20 heures de lecture
Upon its publication in Germany in 1983, this author's book stirred both critical acclaim and consternation, attracting a wide readership. He finds cynicism the dominant mode in contemporary culture, in personal and institutional settings; his book is both a history of the impulse and an investigation of its role today, among those whose earlier hopes for social change have crumbled and faded away.